INFORMATIONS PRATIQUES
INFORMATIONS PRATIQUES
- Lun - Ven
- -
- Sam - Dim
- Fermé
Retrouvez l’actualité juridique du cabinet ATRHET à Lyon
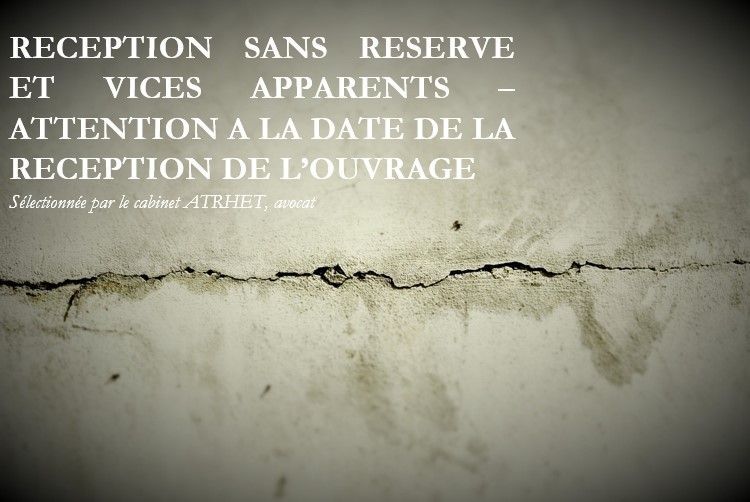
S’il est de jurisprudence constante que les défauts de conformité et vices de construction apparents sont couverts par une réception sans réserve (C.Cass., Civ. 3ème, 9 octobre 1991, n°87-18.226), encore faut-il que le vice de construction soit apparent au moment de la réception de l’ouvrage.
Cette précision, qui peut apparaitre comme une lapalissade, n’est en réalité pas sans poser de difficulté en cas de réception tacite des travaux. En effet, une telle réception ne se matérialise pas par un procès-verbal de réception avec une date certaine, mais se prouve par la réunion de divers indices (prise de possession de l’ouvrage, paiement complet des divers locateurs d’ouvrage) desquels l’on déduira la volonté non-équivoque du maître de l’ouvrage de réceptionner les travaux (C.Cass., Civ. 3ème, 18 avril 2019, n°18-13.734). Dès lors comment peut-on déterminer si des désordres visibles dénoncés par le maître d’ouvrage pouvaient être considérés comme apparents lors de la réception tacite ? Rien n’est moins évident, comme le démontre l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 18 janvier 2024 (C.Cass., Civ. 3ème, 18 janvier 2024, n°22-22.480).
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence avait débouté le maître d’ouvrage de sa demande d’indemnisation au motif que le désordre concernant le positionnement de l’armature du fond mobile de la piscine qu’il avait fait construire était apparu dès la mise en service de la piscine. La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel car celui-ci ne s’expliquait pas sur le fait de savoir si la mise en service de l’installation était concomitante à la réception tacite ou, au contraire, postérieure à celle-ci comme l’alléguait le maître d’ouvrage. La Cour de cassation a ainsi censuré le raisonnement de la Cour d’appel qui avait assimilé sans explication la réception tacite à la mise en service de l’installation. In fine, cela sous-entend qu’il faut distinguer la prise de possession de l’ouvrage, élément intrinsèque de la réception, de son utilisation (ici mise en service).
Pour renforcer davantage la cassation de l’arrêt d’appel, la Cour a ajouté que la Cour d’appel n’a pas constaté que la visibilité « du défaut de positionnement de l’armature permettait au maître d’ouvrage d’appréhender toutes ses conséquences sur les parois de la piscine », confirmant ainsi sa jurisprudence constante selon laquelle les désordres ou non-conformités potentiellement visibles à la réception des travaux sont tenus pour cachés lorsque le maître de l’ouvrage n’a pas pu en apprécier le degré de gravité et n’a donc pas été en mesure de réserver lesdits désordres ou non-conformités (C.Cass., Civ. 3ème, 23 avril 1997, n°95-13.482 ; C.Cass., Civ. 3ème, 16 septembre 2014, n°13-21.063 ; C.Cass., Civ. 3ème, 16 février 2022, n°21-12.828).
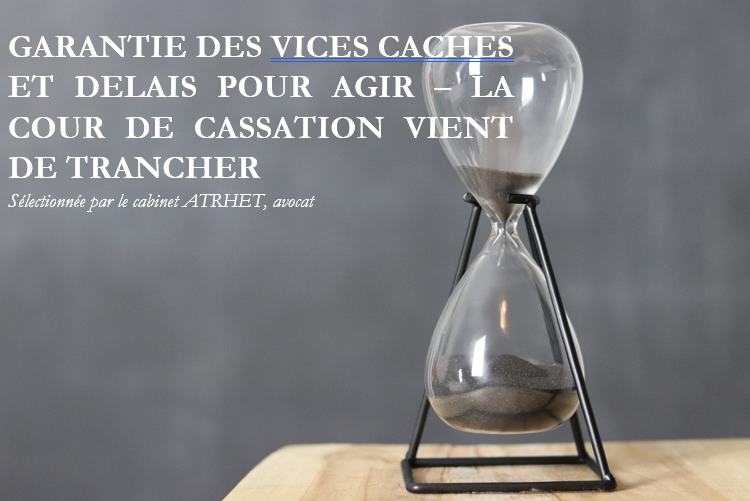
Par quatre arrêts rendus le 21 juillet 2023 (n°21-15.809, n°21-17.789, 21-19.936, n°20-10.763), la Chambre mixte de la Cour de cassation vient répondre aux diverses questions touchant au délai biennal de l’action en garantie des vices cachés prévu par l’article 1648 du Code civil.
La première question était de savoir si ce délai est, en l’absence d’indication du texte légal, un délai de prescription susceptible d’interruption et de suspension ou un délai de forclusion seulement susceptible d’interruption. Alors que la troisième chambre civile de avait qualifié l’année dernière le délai de forclusion (C.Cass., Civ. 3ème, 5 janvier 2022, n°20-22.670), la Chambre mixte (regroupant les première et troisième chambres civiles ainsi que la chambre commerciale) a tranché en faveur de la prescription.
La Cour justifie sa position d’abord par les divers rapports accompagnant l’ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 ainsi que le projet de loi de ratification, mentionnant « un délai de prescription » pour l’action en garantie des vices cachés, ensuite par l’objectif poursuivi par le législateur qui est de permettre à l’acquéreur d’être en mesure d’agir contre le vendeur dans un délai susceptible d’interruption et de suspension.
La seconde question portait sur la durée du délai butoir à l’expiration duquel il n’est plus possible d’exercer l’action en garantie des vices cachés.
Auparavant, la jurisprudence estimait que ce délai butoir était le délai de prescription de droit commun qui commençait à courir à compter du jour de la conclusion du contrat, de sorte que ce délai venait encadrer le délai biennal de l’action en garantie des vices cachés qui court à compter de la connaissance du vice.
Dans ses arrêts du 21 juillet, la Cour écarte le délai de la prescription de droit commun (aujourd’hui de cinq ans) comme délai butoir. Elle justifie son raisonnement en expliquant que, depuis la réforme de la prescription de 2008, le point de départ du délai de prescription de droit commun se confond désormais avec celui du délai biennal de la garantie des vices cachés, à savoir la connaissance du droit d’agir en justice. Il n’est donc plus possible d’analyser le délai de prescription de droit commun de cinq ans comme un délai butoir spécial venant encadrer l’action en garantie des vices cachés.
La Cour a précisé que le délai butoir de l’action en garantie des vices cachés est le délai de 20 ans prévu à l’article 2232 du Code civil depuis 2008 en matière de prescription.

Ces deux arrêts constituent une véritable évolution jurisprudentielle puisqu’ils ont amélioré le droit des dirigeants des sociétés lors du contrôle fiscal (Conseil d'État 30 décembre 2021, N° 439797 ; Cour administrative d’appel de Lyon, 17 mai 2023, N° 21LY04320). Il résulte de ces deux arrêts, rendus dans une affaire que nous suivons depuis 2018, que lors de la vérification de comptabilité d’une société, si les conséquences de cette vérification risquent de toucher son dirigeant, l’administration fiscale est tenue d’informer la société de son droit d’être assistée d’un conseil.
Elle est aussi tenue de le faire, dans un acte distinct, par courrier recommandé respectant la législation postale, au dirigeant de cette dernière. Il s’agit d’une évolution de la jurisprudence, car le Conseil d’État excluait les tiers, y compris les dirigeants, des personnes à qui le droit d’être assisté devait être notifié (CE, du 23 décembre 1964, req. n° 62897).
Cette évolution devrait amener l’administration à changer de doctrine https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/244-PGP.html/identifiant%3DBOI-CF-PGR-20-20-20171004
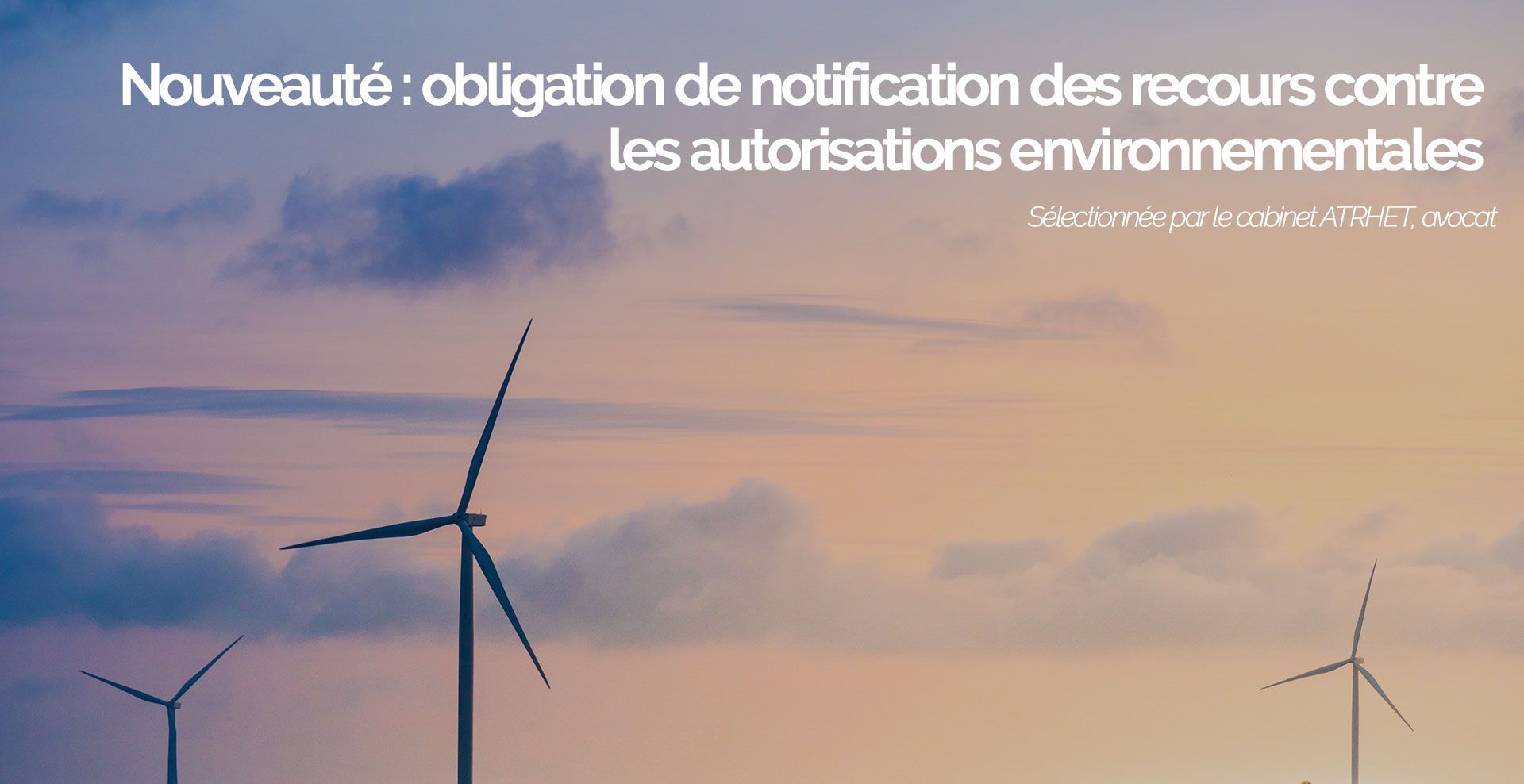
L’autorisation environnementale, qui dispense de permis de construire les projets d’éoliennes d’une certaine taille, n’était pas soumise à l’obligation de notifier le recours la contestant à son auteur et à son bénéficiaire, comme c’est le cas du recours contre le permis de construire. Pour permettre aux bénéficiaires d’autorisations environnementales d’être informés rapidement des contestations contre elles, le législateur a décidé, dans l’article 23 de la LOI n°2023-175 du 10 mars 2023, d’obliger l’auteur d’un recours contre une autorisation environnementale de notifier ce recours, à peine d’irrecevabilité, à l’auteur de cette autorisation et à son bénéficiaire.
Le Conseil Constitutionnel a été saisi pour se prononcer sur la constitutionnalité de ces dispositions, dont il a, le 9 mars 2023, décidé qu’elles sont conformes à la Constitution (CC, Décision n° 2023-848 DC du 9 mars 2023). Elles ont ensuite été codifiées dans
l’article L. 181-17 du Code de l’environnement, lequel est entré en vigueur le 12 mars 2023.
À partir de l’entrée en vigueur de ce texte, le recours contre une autorisation environnementale doit, à peine d’irrecevabilité, être notifié à l’auteur de cette autorisation et à son bénéficiaire. Les conditions d'application de ce texte doivent être précisées par un décret en Conseil d'Etat qui n’a pas encore été pris.
Pour être prudent, il convient de notifier les recours contre les autorisations environnementales introduits depuis le 13 mars 2023. Même si l’article L. 181-17 du Code de l’environnement n’est pas précis sur les conditions de cette notification, notamment sur le délai et la forme, il est possible de s’inspirer de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme. En effet, le Conseil d’Etat a estimé que l’article 23 de la LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 est directement inspiré des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, applicables aux autorisations d’urbanisme (CE, séances des 15 et 22 septembre 2022).
horaires d'accueil
Lundi au vendredi de 9h à 20h
horaires téléphoniques
Lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
Plan du site
Tous droits réservés
SAS ATRHET

